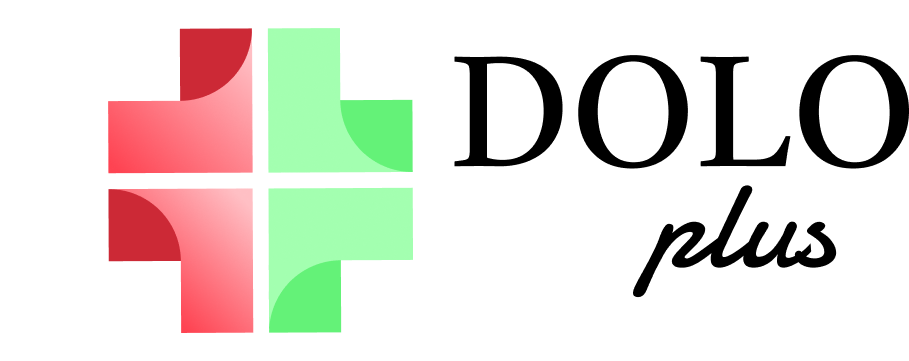La radiothérapie constitue l'un des piliers du traitement contre le cancer, notamment dans les zones de la tête et du cou. Si son efficacité pour détruire les cellules cancéreuses n'est plus à démontrer, elle peut également affecter les tissus sains environnants et provoquer divers effets secondaires. Parmi ceux-ci, les troubles de la déglutition représentent une complication fréquente et souvent méconnue qui peut considérablement impacter la qualité de vie des patients. Comprendre ces manifestations et connaître les solutions disponibles permet d'anticiper et de mieux gérer ces difficultés tout au long du parcours de soins.
Les troubles de la déglutition causés par la radiothérapie
La dysphagie post-radique : symptômes et mécanismes
La dysphagie désigne la difficulté à avaler les aliments depuis la bouche jusqu'à l'estomac. Ce trouble affecte plus de 80 pour cent des patients traités pour un cancer de la sphère ORL. Lorsque la radiothérapie est appliquée dans la région de la tête et du cou, elle peut provoquer une inflammation locale accompagnée de douleur, de sécheresse buccale et d'une modification de la consistance de la salive qui devient plus épaisse. Ces premiers symptômes surviennent généralement pendant le traitement ou dans les semaines qui suivent son achèvement.
Au-delà de ces manifestations précoces, la radiothérapie entraîne progressivement une sclérose des tissus, c'est-à-dire la formation de tissu cicatriciel qui rigidifie les structures impliquées dans la déglutition. Cette fibrose peut provoquer un trismus, c'est-à-dire une difficulté à ouvrir la bouche, ainsi qu'une diminution de la mobilité de la langue et de la gorge. Les muscles qui protègent normalement les voies respiratoires s'affaiblissent, tandis que l'œsophage peut se rétrécir. L'affaiblissement des nerfs faciaux et la paralysie de certaines structures complètent ce tableau clinique complexe.
Les zones à risque lors du traitement par radiation
Les cellules qui se divisent rapidement sont les plus vulnérables aux effets de la radiothérapie. Ainsi, la peau, la muqueuse de la bouche, le tube digestif et la moelle osseuse figurent parmi les tissus les plus exposés. Lorsque la radiothérapie cible le cerveau, la tête ou le cou, elle peut occasionner des lésions cutanées, une perte de cheveux localisée, des douleurs buccales intenses appelées stomatites, une sécheresse buccale persistante appelée xérostomie, des changements de goût et des difficultés à avaler.
Le larynx, la gorge et l'œsophage constituent des zones particulièrement sensibles. L'inflammation de la muqueuse œsophagienne, ou œsophagite, provoque des brûlures et des douleurs lors de la déglutition, un symptôme nommé odynophagie. La dose de radiation administrée, le type de radiothérapie utilisée et l'état de santé général du patient influencent l'intensité et la durée de ces effets indésirables. Les rayonnements endommagent non seulement les cellules cancéreuses mais aussi les cellules saines avoisinantes, ce qui explique la variété des complications observées.
Reconnaître les signes d'alerte pendant et après le traitement
Les manifestations précoces des difficultés à avaler
Dès le début de la radiothérapie, certains symptômes peuvent alerter le patient et son entourage. La sensation que les aliments restent coincés dans la gorge ou l'œsophage constitue l'un des premiers signes. Des épisodes de toux, d'étouffement ou de haut-le-cœur lors des repas signalent également une difficulté croissante à gérer le passage des aliments. Ces manifestations s'accompagnent souvent de douleurs dans la gorge qui rendent l'acte de manger pénible et anxiogène.
L'altération du goût et la sensation de salive épaisse compliquent davantage l'alimentation. Le gonflement des tissus et l'inflammation locale augmentent l'inconfort. Une perte d'appétit apparaît fréquemment, causée par la combinaison de la douleur, de la sécheresse buccale et de la difficulté à avaler. Les patients rapportent également des sensations de brûlures d'estomac et des reflux lorsque l'œsophage est particulièrement touché. Ces symptômes initiaux doivent être signalés rapidement à l'équipe soignante afin d'adapter la prise en charge.
L'évolution des symptômes sur le long terme
Si la plupart des effets secondaires s'atténuent quelques semaines à quelques mois après la fin du traitement, certains peuvent persister ou apparaître de manière différée. La fibrose tissulaire s'installe progressivement et peut continuer à évoluer plusieurs années après la radiothérapie. Cette évolution tardive explique pourquoi des patients qui avaient retrouvé une déglutition satisfaisante constatent une dégradation progressive de leur capacité à avaler.
Les complications à long terme incluent un rétrécissement persistant de l'œsophage appelé sténose, qui nécessite parfois des interventions de dilatation. Les fausses routes, c'est-à-dire le passage d'aliments ou de liquides dans les voies respiratoires au lieu de l'œsophage, deviennent plus fréquentes et exposent au risque d'infections pulmonaires comme la pneumonie d'aspiration. Une perte de poids inexpliquée, une fatigue accrue et des infections respiratoires répétées constituent autant de signaux d'alarme justifiant une consultation, même plusieurs années après la fin des traitements.
Solutions pratiques pour soulager les problèmes de déglutition
Adapter son alimentation et ses habitudes quotidiennes
La modification de l'alimentation représente l'une des stratégies les plus efficaces pour gérer la dysphagie. Il convient de privilégier des aliments mous ou lisses, faciles à avaler, et d'ajouter des sauces pour faciliter le passage. Les plats riches en protéines et en calories permettent de compenser la diminution des quantités ingérées. Ramollir les aliments secs en les humidifiant ou en les mixant réduit considérablement les difficultés. Les aliments durs, secs ou qui s'émiettent doivent être évités car ils augmentent le risque de fausse route.
Il est recommandé de couper les aliments en petits morceaux, voire de les hacher, et de prendre de petites bouchées. L'épaississement des liquides facilite leur contrôle dans la bouche et diminue le risque qu'ils passent dans les voies respiratoires. Privilégier les plats froids ou tièdes plutôt que chauds limite l'irritation des muqueuses enflammées. Les aliments épicés, acides ou très sucrés doivent être limités car ils aggravent l'inflammation. L'alcool et le tabac sont à proscrire en raison de leur effet irritant.
Pour lutter contre la sécheresse buccale, il est essentiel de boire beaucoup de liquides tout au long de la journée. Mâcher des chewing-gums sans sucre stimule la production de salive. L'utilisation d'un humidificateur dans la chambre améliore le confort nocturne. Pendant les repas, il convient de s'asseoir bien droit afin de favoriser la descente des aliments par gravité. Prendre son temps, éviter les distractions et se concentrer sur chaque bouchée permettent de mieux contrôler la déglutition et de réduire les accidents.

Les exercices de rééducation et accompagnement orthophonique
La rééducation orthophonique joue un rôle central dans la prise en charge des troubles de la déglutition. Un orthophoniste spécialisé propose des exercices ciblés pour renforcer les muscles de la langue, de la mâchoire et de la gorge. Ces exercices d'amplitude de mouvement visent à maintenir ou restaurer la mobilité des structures impliquées dans la déglutition. Ils incluent des mouvements de la langue dans toutes les directions, des ouvertures maximales de la bouche et des exercices de propulsion du larynx.
La kinésithérapie complète cette approche en travaillant sur les muscles du cou et en luttant contre la raideur articulaire liée au trismus. Ces séances de rééducation doivent idéalement débuter pendant le traitement et se poursuivre régulièrement après son achèvement. La persévérance dans la pratique quotidienne de ces exercices conditionne largement leur efficacité. Un suivi régulier permet d'adapter les techniques en fonction de l'évolution des symptômes.
L'évaluation de la déglutition par radiographie spéciale permet de visualiser précisément les mécanismes en jeu et d'identifier les dysfonctionnements. Cette exploration guide le choix des stratégies thérapeutiques les plus appropriées. Dans certains cas, des injections de toxine botulique ou de produits volumateurs peuvent améliorer la fonction musculaire. Les gestes de dilatation œsophagienne s'avèrent nécessaires lorsqu'un rétrécissement gêne significativement le passage des aliments.
Accompagnement médical et suivi personnalisé
Le rôle des professionnels de santé dans la prise en charge
La gestion optimale de la dysphagie post-radique repose sur une approche multidisciplinaire coordonnée. L'équipe soignante réunit des médecins oncologues et radiothérapeutes, des infirmiers spécialisés, des orthophonistes, des kinésithérapeutes et des diététiciens-nutritionnistes. Cette collaboration garantit une prise en charge globale qui prend en compte tous les aspects du problème, depuis la dimension physique jusqu'aux répercussions psychologiques et nutritionnelles.
Les médecins surveillent l'évolution des symptômes et prescrivent les traitements adaptés pour soulager la douleur et l'inflammation. Les médicaments antalgiques permettent de rendre les repas plus confortables. En cas de complications comme les infections pulmonaires liées aux fausses routes, des antibiotiques sont nécessaires. Le suivi régulier inclut des bilans cliniques et parfois des examens complémentaires pour évaluer l'état des tissus et détecter d'éventuelles complications tardives.
Des structures spécialisées comme l'Institut d'orthophonie du Memorial Sloan Kettering proposent des consultations dédiées aux troubles de la déglutition liés au cancer. Ces centres offrent une expertise pointue et un accompagnement personnalisé. Il est important de contacter l'équipe soignante dès l'apparition de symptômes inquiétants tels qu'un essoufflement, une respiration sifflante ou douloureuse, une toux productive avec sécrétions ou une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius, car ces signes peuvent indiquer une complication respiratoire grave.
Les traitements complémentaires et conseils nutritionnels
Le soutien nutritionnel constitue un pilier fondamental de la prise en charge. Un diététicien-nutritionniste évalue les apports alimentaires, calcule les besoins caloriques et protéiques, puis propose des adaptations personnalisées. L'objectif est de prévenir ou de corriger la dénutrition qui aggrave la fatigue, ralentit la cicatrisation et diminue les défenses immunitaires. Des compléments nutritionnels oraux enrichis peuvent être prescrits pour compléter l'alimentation habituelle.
Lorsque les troubles de la déglutition s'aggravent au point de compromettre les apports nutritionnels malgré toutes les adaptations, l'alimentation par sonde devient nécessaire. La gastrostomie consiste à placer un tube directement dans l'estomac à travers la paroi abdominale. Cette solution temporaire ou prolongée garantit que le corps reçoit l'ensemble des nutriments indispensables à son fonctionnement et à la poursuite des traitements. Loin d'être un échec, elle représente un outil précieux pour préserver l'état nutritionnel et éviter les hospitalisations.
Le maintien d'une activité physique adaptée, même modérée, contribue à lutter contre la fatigue, à préserver la masse musculaire et à améliorer le moral. La marche quotidienne, les exercices de respiration et les activités douces comme le yoga ou la natation sont particulièrement bénéfiques. Des associations de patients et des groupes de soutien, comme ceux proposés par l'International Association of Laryngectomees, offrent un espace d'échange et de partage d'expériences qui aide à mieux vivre cette épreuve. La Société canadienne du cancer met également à disposition des ressources et un soutien téléphonique pour accompagner les patients et leurs proches tout au long du parcours de soins.